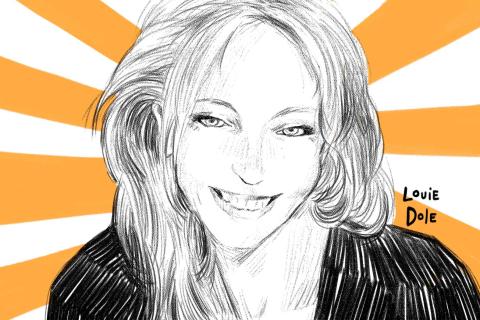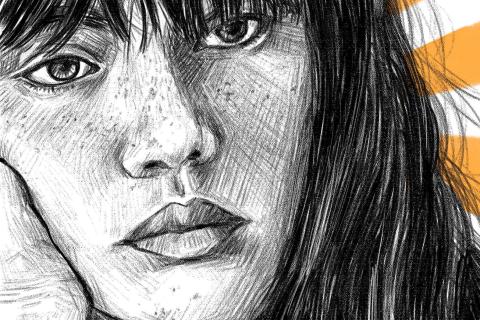Atrium57 // Culture, genre et architecture : un trio à garder à l’œil
Rencontre avec Marie-Ève Lejuste, architecte, et Éric Mat, directeur de l’Atrium 57
Rédaction : Rébecca Deville / Photos : Sophie Lex
L’Atrium 57, ce nom vous dit peut-être quelque chose. C’est celui du nouveau centre culturel de la ville de Gembloux. Il a une spécificité qui nous a donnée envie de nous y intéresser un peu plus. Il fait partie des rares centre culturels à avoir été rénové par une architecte. En quoi cela est digne d’intérêt vous direz-vous ? Les femmes architectes cheffes d’un bureau sont comme des perles au creux des huitres : elles sont rares ! L’occasion était donc toute trouvée pour discuter avec Marie-Ève Lejuste (MEL) de sa vision de l’architecture au féminin et de son travail de rénovation de l’Atrium 57. Tout cela, accompagné d’Éric Mat (EM), le directeur du centre.
La culture est devenue un concept.
Cinqmille : Pour commencer, pourquoi avoir rénové ce centre au lieu d’en rebâtir un ailleurs ?
Éric Mat : C’était une volonté du centre depuis des décennies. Il y avait une demande d’adaptation des locaux par rapport à ce qu’est l’offre culturelle actuelle. La culture est devenue un concept : il y a un avant, un pendant, un après. On était obsolète au niveau qualité d’accueil, de modernité ou même d’image ! Marie-Eve a traduit ça admirablement bien !
En tout et pour tout, cela a pris 30 ans pour que tout s’accorde : la demande du centre devait être entendue, la ville devait avoir les finances, l’appel à projet devait être lancé et Marie-Eve devait exister !
C : Pouvez-vous nous expliquer tous les changements qui ont été opérés ?
EM : Il y en a eu énormément : la scène, les places assises, les lieux de vies, les espaces extérieurs, etc. Nous en avons beaucoup discuté avec Marie-Eve afin de mettre le doigt aussi sur tous les points nécessaires pour les personnes qui vont travailler ici au quotidien. Ces changements devaient faire sens et donc l’architecture aussi.
Marie-Ève Lejuste : Oui, on a beaucoup discuté avec l’équipe du centre pour que chaque travailleur (autant de l’administratif que ceux qui s’occupent de la scène) puisse partager ses besoins. Cela a toujours évolué en partenariat et cela a rendu ce projet très riche.
Ce qui est fort ressorti à l’Atrium, c’est la collaboration avec les occupants du lieu.
C : En tant qu’architecte, c’est votre premier centre culturel à rénover ?
MEL : Je faisais un autre centre culturel à Moustier mais c’était une nouvelle construction donc ce n’était pas vraiment la même chose. Ce qui est fort ressorti à l’Atrium, c’est la collaboration avec les occupants du lieu. C’est une vraie richesse pour pouvoir concevoir un lieu qui réponde vraiment aux besoins de ces personnes. J’ai appris énormément au niveau de l’acoustique et de la scénographie par exemple. J’étais bien entourée pour toutes ces compétences !
EM : Très masculin d’ailleurs cet entourage !
MEL : C’est vrai qu’il n’y avait quasi que mon équipe qui était composée de femmes…
C : Comme vous venez de le dire, vous n’avez que des collaboratrices dans votre bureau. C’est un choix conscient ?
MEL : Non, pas du tout. Ce sont des femmes compétentes et investies. Et il y a une bonne ambiance dans l’équipe. Je les ai choisies pour la qualité de leur travail, elles bossent super bien.
C : Et est-ce que vous ressentez une sorte de sororité en ayant uniquement des collaboratrices ?
MEL : Dans un sens, oui. Je ne ressens pas de sexisme « direct » dans le cadre de mon travail. Je ne me suis jamais faite siffler sur chantier. Tout se passe toujours bien. Je pense, cependant, que des fois je dois prouver mes compétences, mon savoir-faire. Mais, il est vrai que je ne sais pas si cela est pareil pour les jeunes garçons… Et concernant la sororité, il y a peut-être plus une corporation avec les garçons. Moi, le soir, je privilégie ma vie de famille, je ne vais pas boire des verres avec des collègues. Si je trouve un groupe d’architectes, je vais aller vers les femmes pour partager nos expériences. Et on essaie de s’entraider, de s’encourager. Si je peux donner du boulot, je vais conseiller une collègue donc la sororité peut apparaitre de cette façon.
il y a des femmes qui sont des collaboratrices ou indépendantes dans des bureaux mais elles n’ont pas le devant de la scène.
C : Force est de constater qu'il est relativement difficile de trouver des projets architecturaux importants dessinés par des femmes ? A quoi est-ce dû selon vous ?
MEL : Je pense que cela s’explique par le fait que beaucoup de femmes partent vers l’administratif ou comme employées. Cela donne une sécurité d’emploi et des horaires fixes peut-être plus faciles à associer à une vie de famille. Mais il faut savoir qu’en tant qu’indépendante, si je veux arrêter à 16h pour aller chercher mes filles à l’école, je peux le faire. Je suis flexible et je le dis aussi à mes collègues. Elles sont indépendantes donc cela reste très facile au niveau du temps. A certains moments, je peux aller à une réunion de parents en plein milieu de la journée mais les vacances, je bosse et mes filles doivent faire des stages. Comme tout parent en somme !
Quoi qu’il en soit, il ne faut pas oublier que dans ces bureaux d’hommes : il y a des femmes qui sont des collaboratrices ou indépendantes dans des bureaux mais elles n’ont pas le devant de la scène. Cela reste les petites mains et qui sont invisibilisées. Le métier se féminisme énormément donc je ne doute pas de voir de plus en plus de femmes architectes sous les projecteurs.
Je suis fière de dire que je suis une femme et que j’ai réussi à réaliser un chantier jusqu’au bout.
Crédit Photo : Sophie Lex Crédit Photo : Sophie Lex
C : Est-ce que vous diriez que l’architecture est genrée ? Le travail d’une femme est autre que celui d’un homme ?
MEL : C’est une bonne question ! Je trouve que cela peut se ressentir dans les finitions où il y a plus de matériaux ou de couleurs différentes quand c’est une femme qui travaille. Cependant, quand on voit l’architecture de Zaha Hadid, cela reste assez dur et froid donc je me perds peut-être dans des suppositions… C’est difficile de parler du genre car j’ai peur de stigmatiser mais en même temps, il faut en parler. Je suis fière de dire que je suis une femme et que j’ai réussi à réaliser un chantier jusqu’au bout. Je reste persuadée que des personnes ne veulent pas donner des projets à des femmes. Il est vrai, par contre, qu’on m’a déjà fait plusieurs fois la remarque que je faisais attention à des détails, lors de la conception, qui vont impacter le quotidien des personnes y habitant. Par exemple, avoir une superbe baie vitrée mais prévoir l’accessibilité pour la nettoyer.
Concernant les espaces extérieurs, cela reste hyper important qu’ils soient pensés par des femmes aussi car ils ne sont pas toujours sécurisés. Les femmes vont probablement penser à cela et faire en sorte que l’espace donne envie d’y rester et de ne pas être qu’un lieu de passage.
C : Et tant que femme indépendante, comme c’est passé votre confinement ?
MEL : C’était l’horreur ! J’ai trois filles et la plus petite a 2 ans. Je travaillais pendant qu’elle faisait la sieste. J’allais sur chantier tôt le matin et je bossais de 20h à 1h du matin. Je suis sortie épuisée de ce confinement. Puis il y avait cette culpabilité qui vient s’ajouter quand on voit d’autres mamans faire des gâteaux, des balades à vélos avec leurs enfants. J’étais tiraillée entre mes clients et mes filles, c’était clairement dur. Des papas vont peut-être dire la même chose mais de ce que j’entends autour de moi, cela reste plus les femmes, les mères qui portent la gestion de leur carrière et leur vie de famille sur leurs épaules.
C : Pour terminer, que diriez-vous aux jeunes filles pour leur donner envie de faire ce métier ?
MEL : C’est un métier très riche autant sur le plan technique que sur le plan humain. On doit rencontrer plein de personnes différentes et gérer cela. Je ne vais pas communiquer de la même manière avec un entrepreneur qu’avec une administration. Et il y a un vrai lien qui se fait avec les clients aussi, on rentre de leur bulle de vie. J’ai côtoyé le personnel de l’Atrium pendant 2 ans, on se voyait quasi quotidiennement et cela a été une sorte de petit déchirement quand le projet s’est terminé. Mais on rebondit et on passe au projet suivant pour s’immerger dans une autre bulle et tisser un lien avec d’autres personnes.
Concernant le plan technique, on apprend de tout ! J’ai appris, sur le projet de l’Atrium, des techniques concernant l’acoustique ou la scénographie. J’avais travaillé sur un autre projet concernant un commissariat aussi où je devais penser à la conception des cellules, etc. Ce sont des savoirs qu’on ne touche pas dans notre quotidien donc pouvoir y accéder via ce métier d’architecte est vraiment enrichissant. On est de vrais couteaux-suisses ! Le métier se féminise vraiment ce qui est une vraie plus-value pour ce milieu.
La question de la conciliation des temps de vie (vie professionnelle/vie sociale/vie privée/…) se pose, encore aujourd’hui, beaucoup plus pour les femmes que pour les hommes. En 2016, l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes publiait « si nous considérons l’emploi du temps des femmes et des hommes comme un reflet fidèle de la manière dont ils organisent leur quotidien, nous constatons que les stéréotypes de genre sont encore aussi immuables qu’il y a 15 ans. Les hommes consacrent davantage de temps que les femmes au travail rémunéré et les femmes consacrent, elles, davantage de temps aux tâches ménagères et aux enfants. (…) Les stéréotypes de genre quotidiens sont immuables, mais surtout, ils semblent encore bien plus présents qu’avant 2013. Le fossé en termes de durée de temps de loisirs entre les femmes et les hommes s’est élargi. Il s’agit de la conséquence d’une augmentation de temps de loisirs chez les hommes… ».
4 ans après, L’expérience du confinement est venue encore visibiliser davantage la part que peut prendre le « soin aux autres » dans la vie des femmes. Quand les écoles ferment, qui a peur de ne pas pouvoir assumer ses missions professionnelles ? Qui est soumise aux diktats de la « mère parfaite » qui arrive à tout gérer et à organiser des activités de qualité et épanouissantes avec ses enfants? Qui se retrouve seule à gérer tout, dans les familles monoparentales, qui ont en majorité une femme à leur tête… ?
Selon les calculs tout récents d’Oxfam, 42% des femmes dans le monde ne peuvent avoir un travail rémunéré « en raison d’une charge trop importante du travail de soin qu’on leur fait porter dans le cadre privé/familial », contre seulement 6 % des hommes.
Entre partage des tâches encore fortement genré et inégalitaire, et « charge mentale ¹ » massivement assumée par les femmes, la vie d’une majorité de femmes se modèle souvent pour être au service de leur entourage dans la sphère privée (et on est loin de la caricature quand on dit ça : le nombre de femmes qui parlent encore de « rentrer pour faire leur souper ou leur repassage, leur nettoyage, leur ménage » en atteste)…
Héritée directement de notre socialisation genrée et des notions de don de soi et de sacrifice qui la sous-tendent, comme «caractéristiques typiquement féminines » (« on m’a toujours dit que je devais être disponible pour les autres »), la charge mentale confine les femmes dans un rôle qui limite leurs marges de manœuvre et l’amplitude de leurs propres choix.
Si elle est difficilement quantifiable, cette « charge mentale » est très souvent évoquée par les femmes comme une dimension transversale, relativement lourde à vivre, puisqu’en plus, par définition, elle ne s’arrête jamais…
Une injustice particulièrement indétectable dans ce monde qui préfère souvent feindre que l’égalité est atteinte (c’est tellement plus pratique…), plutôt que d’écouter ce que les femmes vivent réellement !
Et si nous connaissons toutes quelques hommes qui sont de vrais alliés magnifiques (!), aidons-les à faire tâche d’huile, en continuant à dire, simplement, sobrement, ce qui ne nous convient pas dans l’explicite (et le « à peine implicite ») de nos « destins » assignés de femmes…
Dire qu’on n’est pas d’accord n’est pas mû par la volonté d’attaquer ou de blesser, juste par l’espoir…
Aurore K
¹ La charge mentale, c’est cette responsabilité assumée par une majorité de
femmes et qui consiste à organiser/planifier/programmer la vie quotidienne. Ça va de la gestion de l’agenda collectif – «On attend de moi que je « pense à tout», que je sois la « fonction rappel », aux multiples rendez-vous familiaux ou dans l’entourage à assurer (« Plus beaucoup de temps pour moi, une fois que j’ai tout réglé »), en passant par l’anticipation globale de la vie familiale.
Quelques liens :
https://atrium57.be
http://www.lejustearchitecte.be